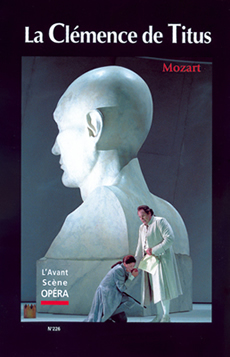D’où écrire, à partir de quel lieu, de quel plan penser ce qui incarne l’ailleurs, l’Alien, l’intrus ? Comment interroger ce qui, sous le choc des affects de la crise et de la terreur, suspend toute interrogation? Dans un déplacement de la Poétiqued’Aristote, en lieu et place de la purgation d’émotions, de la catharsis que la tragédie offrirait par la mise en scène de la pitié et de la terreur, les films de science-fiction, resserrés ici autour de la tétralogie d’Alien et de Prometheus, opéreraient-ils une catharsis sur base de crise et de terreur? Ou rendent-ils la catharsis impossible? Arrêtée à ce jour à quatre films[1](mais appelée à proliférer comme prolifèrent les Aliens dits xénomorphes), la saga Alien questionne la problématique de l’identité humaine, de l’intégrité individuelle, du corps par le biais de leurs limites, de leurs devenirs, leurs mutations. On l’envisagera d’une part sous l’angle des registres métaphysiques qu’elle convoque, des opérateurs de pensée qu’elle met en œuvre, d’autre part sous l’angle des effets qu’elle produit dans le chef des spectateurs. Le climat qu’elle distille a pour nom inquiétante étrangeté. Dès Alien, le huitième passager, le ton est donné, lequel se poursuivra dans les films qui en composent la suite : le surgissement de l’Alien, à savoir de l’irrepérable, de l’inclassable provoque un vacillement des grilles perceptives des membres de l’équipage du vaisseau Nostromo. L’apparition de l’autre sous la guise d’une autre forme (“xéno”-“morphe”) dissout la certitude du sujet sur lui-même et agit comme un traumatisme objectif (délitement des repères mondains) et subjectif (tombée du “je” dans l’inconsistance). La relation avec un autre non catégorisable fracture la détermination du sujet par auto-position de soi et le livre au cauchemar de l’être pur. Les grilles d’appréhension du monde, la batterie des catégories qui permettent d’affronter le réel, de se repérer dans le tissu mondain ne fonctionnent plus. La rencontre de l’Autre (qu’il soit ou non une projection de l’altérité qu’on porte en soi importe peu à ce stade, nous sommes au premier niveau d’une rencontre effractive, traumatisante) qu’on a à juste propos dénommée rencontre du troisième type, brise les schèmes usuels de pensée et d’action, fait voler en éclats les anticipations de la perception, le socle de notre rapport à soi, aux autres et au monde. Proche de l’angoisse heideggérienne, laquelle permet de reconnecter le plan de l’être à partir de la débandade du plan ontique, à même la rupture du lien intentionnel[2], l’épouvante qui s’empare des humains confrontés à la surrection de l’Alien fait sortir le réel de ses gonds et met en déroute l’aperception de soi, l’ipséité.
Face à l’angoisse, à l’effroi comme Stimmung, deux réponses s’ouvrent : se raidir dans un repli sur soi, dans un refus de la nouveauté qui se présente ou inventer une alliance avec les mutants, un pacte avec l’autre qui implique d’expérimenter sur soi devenirs et métamorphoses. Au travers des quatre films, la première réponse s’offre comme la riposte la plus courante dans le chef des humains : leur réflexe est celui d’une fermeture, d’une guerre sans merci qui a pour cadre une lutte à mort effective. La lutte hégélienne, “de pur prestige”, pour la reconnaissance des consciences fait place à un conflit pour la non-reconnaissance, pour la non-médiation. Le maître n’est pas celui qui, ne reculant pas devant le risque de mort, asservit l’esclave tout en le laissant en vie mais celui qui, se repliant sur un rapport immédiat à soi sans l’autre, élimine l’adversaire[3]. Reprenant les concepts de Catherine Malabou, l’on dira que la logique qui préside au conflit à mort privilégie l’altérité d’une dissymétrie à une altérité de métamorphose et de migration. Notons que les androïdes, par exemple Ash dans le film de Ridley Scott, tentent davantage l’alliance et que le chat se révèle intouchable, non vulnérable, immunisé face aux pouvoirs des Aliens. Non pas que la limite du pouvoir des Aliens s’arrête dès lors qu’on ne leur en confère point : il bat de l’aile face aux androïdes qui, sans odeur, sans sueur ni phéronomes, ne sont pas détectables et ne peuvent être pris comme proie pour la ponte des œufs. Ne s’exerçant pas sur les androïdes, les puissances des Aliens s’arrêtent face au chat qui, en soi ou de façon contingente et aléatoire, désamorce leur instinct prédateur. Alors que le chien est un hôte que les Aliens peuvent parasiter (Alien 3[4]), le chat se soustrait à l’emprise des xénomorphes. Serait-ce en raison d’une indifférence réciproque ? Des forces psychiques chamaniques du félin qui rend inopérante la pulsion de reproduction/pulsion de mort de l’Alien ? La question est laissée dans l’ouvert.
Les conséquences de l’apparition de l’Alien sur le spectateur réverbèrent très exactement celles qu’elle produit sur les humains de la tétralogie : un effondrement du sol psychique, une mise en crise du paradigme de notre identité, du processus de subjectivation, des mécanismes de la reconnaissance. La déliaison de la corrélation harmonieuse entre noèse et noème, entre activité de la conscience et objet appréhendé qu’entraîne l’effraction du xénomorphe s’aiguise dans une aphanisis, un évanouissement de l’identité subjective. L’ébranlement des limites entre dedans/dehors, soi/autre, humanité/extraterrestre délivrera une vérité : l’absence d’une essence humaine préservée en son for intérieur, la déconstruction, l’érosion de la différence entre humains et mutants, androïdes.
L’effroi s’origine dans le délitement de la maîtrise, de l’activité d’une conscience qui voit ses visées subjectives se fracasser dans l’inopérant. Les polarités stables, balisées du monde, l’être-ensemble se délitant, le neutre, l’“il y a” comme l’analyse Jean-Clet Martin apparaît à même la dés-apparition des étants, des existants. La cohérence du rapport entre esprit et monde se brisant, le pacte phénoménologique n’a plus cours. La perte endurée par la décohérence phénoménologique pourrait se voir compensée par le gain d’un accès à une cohérence quantique au sens d’une immersion dans le continuum. À même l’obsolescence de la division entre sujet et objet, à même la crise intentionnelle, on pourrait faire l’épreuve deleuzienne d’une conquête d’un champ impersonnel, d’un plan transcendantal. Mais le maintien d’une tension offrant le visage d’une lutte à mort entre différentes formes du vivant et la forme vivante Alien, l’impossibilité d’aller au-delà de la terreur, de sortir de la crise interdisent ce dynamisme d’un devenir moléculaire, impersonnel, d’une immersion panthéiste dans le cosmos. Confrontés à un point de crise (qui, ne connaissant pas de fin, se réitère indéfiniment sous la figure du surgissement d’un Alien menaçant), les humains en état de panique résistent à leur absorption, refusent le plus souvent d’inventer un agencement avec l’Alien dont il est vrai l’agression et la charge de mort rendent difficiles toutes noces contre-nature, tout apprivoisement. L’Alien donne à vivre une épreuve : une désorientation métaphysique et une débandade existentielle. En proie à un point de catastrophe, à une agression mortelle, l’humain tente de riposter à ce qui le méduse, d’être en prise sur la passivité qui le terrasse. Livré à un ailleurs, à un extime, à un dehors qu’il porte en soi mais qui est externalisé sous une forme indépendante, il reste enferré dans la double disjonction exclusive vie/mort, moi/l’autre : ou bien lui meurt ou bien moi je meurs. La relation que les humains engage avec lui est de l’ordre d’un rapport non spéculaire, non symétrique car dépourvu du schème de la reconnaissance réciproque, à savoir une non-relation. Dans cette lutte à mort, la seule réciprocité, le seul rapport qui demeure est celui de la destruction de l’ennemi.
Percutés par la rencontre de créatures à cheval sur différentes espèces, sur divers règnes, le cerveau, l’ordinateur, l’intelligence artificielle ne les reconnaissent comme rien d’existant. Le heurt avec des monstres du point de vue de Linné, avec des concrétions de matières hybrides, des êtres biomécaniques composés d’un mélange de silicium et de carbone, de métal et de chair déroute les batteries d’intégration dont disposent les humains. C’est proprement à l’inconnu, l’inclassable, l’inappréhendable qu’ils ont affaire. Passé le choc de la première confrontation avec cet objet X, ni naturel ni artificiel, la répétition de la rencontre ne génère pas une habitude perceptive, n’atténue point la dose d’effroi mais radicalise la riposte exterminatrice. Par-delà le danger de prédation/parasitage aboutissant à la mort de la victime, l’Alien menace de retirer à l’humain sa part d’humanité, de l’engloutir dans le chaos, dans un abîme indifférencié. La perspective d’être dépossédé de son identité, de son individuation est davantage source d’effroi que la perspective d’être tué. L’Alien figure une forme de la folie, de la schizophrénie de fait et non de droit pour reprendre la distinction de Deleuze et Guattari. Il nous désaliène de nos schèmas de pensée, de nos habitudes conceptuelles et perceptives mais il nous aliène à l’angoisse de l’indifférencié. La terreur de perdre ce qui est perçu comme son identité naît du fantasme d’un anéantissement. Le fantastique surgit d’une implosion du principe de réalité qui laisse à nu la présence pure, dans un reflux de la sphère des significations. Au travers de l’épreuve de la précarité, de la fragilité de l’identité humaine, du lézardage du socle anthropologique, une révélation se fait jour : il n’y a pas de propre, de nature humaine préservée en ses paramètres essentialistes, le propre n’est propre qu’à être traversé par l’altérité.
La présence du huitième passager dans le Nostromo met à l’épreuve la condition humaine qu’il menace, qu’il distord, parasite, greffe, hybride. Vue du côté de l’Alien, la teneur en menace, et dont les humains (qui ne sont autres que des Aliens pour les Aliens), sont porteurs, n’a rien à envier à celle que les xénomorphes représentent. Habités par la logique du profit, par une volonté expansionniste estampillée d’ultra-libéralisme, les hommes menacent les galaxies, les exo-planètes qu’ils colonisent, asservissent, pillent. Leur seule visée est de capturer des spécimens d’Aliens afin de les réduire à l’état de cobbayes, de les analyser, soutirer leurs puissances (tel leur sang corrosif, acide...), construire des armes biologiques. Dans la tétralogie Alienet dans Prometheus, l’homme est le roi des prédateurs du cosmos, la multinationale Weyland-Yutani qui envoie des vaisseaux aux quatre coins de l’espace vise une conquête illimitée du cosmos en vue de le coloniser, l’arraisonner, détruire ses autres habitants.
Au niveau de l’apparaître, l’épouvante est d’abord de nature scopique : elle s’enracine dans la vision d’une entité inconnue, déroutante dont l’étrangeté de l’aspect physique est au premier abord proprement insoutenable. Sur le plan intersubjectif ainsi qu’au niveau imaginaire et fantasmatique, l’effroi se redouble dans l’exercice d’une lutte à mort censée sauvegarder l’intégrité du sujet. Il serait fécond d’aborder la saga à partir des réflexions éthologiques que Tobie Nathan développe dans Tous nos fantasmes sexuels sont dans la nature[5]. En faisant des Aliens des êtres organico-mécaniques de type insectoïde, la série rencontre la forge des fantasmes sexuels que décrit la psychanalyse et dont les comportements copulatoires des insectes offrent la gamme. Au contact des Aliens, le danger d’une perte de ce qui est revendiqué comme spécificité humaine se cristallise autour de leur mode de reproduction qui implique l’agression, le viol buccal, la paralysie de la proie, son parasitage, sa fécondation forcée et sa mise à mort. Mus par le besoin compulsif de se perpétuer (ce que Kojève dans sa lecture de la lutte des consciences voyait comme le désir animal de l’esclave de conserver sa vie), les Aliens affichent un système de reproduction par parasitage qui rappelle certains insectes et qui, par sa violence, éveille le fantasme et l’actualisation du fantasme d’une possession prédatrice. S’ils parasitent divers types d’organismes vivants, non seulement les humains, mais aussi les chiens, et d’autres espèces extraterrestres comme le Yautja (plus connu sous le nom de Predator dans le film Predatoret le jeu vidéo Aliens vs Predator), toutes les formes du vivant ne sont cependant pas propices à servir d’hôtes asservis à la ponte des œufs des Aliens. Réduites à l’état de matrice, les victimes sont arraisonnées, désubjectivées, ramenées au rang d’objet, d’instrument au service de la propagation de leurs adversaires. Le scénario de l’accouplement comporte trois temps. Après avoir éclôt d’un œuf pondu par une reine, le Facehugger, à savoir un Alien de petite taille, encore au stade larvaire, scrute le passage d’une victime afin de lui sauter au visage, de s’y agripper. La violant par son appendice buccal de forme phallique, le Facehugger la féconde en déposant un œuf dans l’estomac. Se décollant du visage de sa victime (qu’elle soit homme, femme, chien, extraterrestre…), le prédateur meurt tandis que l’hôte subit à son corps défendant le cycle de sa fécondation. Enceinte sans le savoir, portant en son ventre un embryon d’Alien, la victime est anéantie quelques heures après l’agression (parfois quelques jours s’il s’agit d’un œuf porteur d’une reine), tuée par l’expulsion d’un Chestburster qui lui perfore la cage thoracique. Le cycle vital du xénomorphe n’est pas encore achevé : le Chestburster grandit et lorsqu’il arrive à maturité devient un Alien qui traque ses proies. Régis par la seule logique de la prédation assurant leur survie, les Aliens réduisent les êtres qu’ils croisent à l’état de créatures porteuses (dans une indifférenciation des sexes mère/père porteur, la différence sexuelle important peu pour la ponte des œufs). L’implantation forcée d’un embryon dans le corps de la victime comptabilise deux morts pour une vie : la mort du Facehugger qui a fécondé, parasité son hôte et la mort de l’hôte, tous deux sacrifiés au profit de la naissance du Chestburster, lequel se développera en Alien proprement dit au stade adulte.
Dans ses modalité d’effraction dans le réel mais aussi d’agression sexuelle, le surgissement de l’Alien est tout à la fois celui de la Chose, de “das Ding”, de l’être pur sans pôles ontiques de Heidegger et celui de la Chose, du grain de réel pur soustrait au symbolique de Lacan. La perte des repères symboliques actée lors du heurt avec un xénomorphe se radicalise lors de l’insémination forcée (pénétration orale puis éventration). Dans sa grille de lecture féministe appliquée au cycle Alien, Barbara Creed[6]perçoit dans la série l’agissement d’un imaginaire patriarcal qui exorciserait la femme, son étrangeté en l’associant essentiellement à deux figures complémentaires : la mère archaïque, la mauvaise mère, nocive, comme Chose, abysse, indifférencié associé à l’abject, à l’obscène de Kristeva, qui mène à la mort d’une part et la mère phallique, la femme fétiche d’autre part. L’Alien, l’autre en tant qu’autre aurait pour nom la femme. L’effroi qui s’empare des humains traduit la prescience d’un danger/fantasme : être avalé dans le fond sans fond de l’unité originaire, souhaiter le retour à la matrice de la mère archaïque, traversé par le désir de revenir en deçà de la discontinuité, de la coupure entre entités subjectives autonomes afin de renouer avec une fusion mortifère. La réincorporation dans la Chose que figure l’Alien, le retour à la fusion avec la mère signeraient l’annihilation du self. Dans la distribution réglée des marqueurs sexuels ou de genre qui parsèment le cycle, les références à la féminité (séparée de son appariement à la femme) sont multiples et hétérogènes. Quatre références au féminin se dégagent. Primo, la référence à la Reine. Chaque colonie d’Aliens a sa reine, une créature qui trône au sommet de l’organisation sociale, dotée du pouvoir suprême de pondre des œufs. Analogos de la reine des fourmis, elle a à sa disposition des légions de troupes chargées de la reproduction. Les drones, fourmis ouvrières au plus bas de l’organisation sociale des xénomorphes, sont à son service. Mais la fonction de reine n’implique nullement la possession de traits anatomico-biologiques, sexuels précis : tout Alien peut l’occuper. En effet, dès lors que leur survie est menacée par l’absence de Reine, les Aliens adultes ont l’aptitude de muter et de se transformer en Reine dans un réflexe de régulation pragmatique visant à assurer la perpétuation de leur espèce. Secundo, la référence à la femme résistant à sa réduction au principe de fertilité. Dès la première rencontre avec l’Alien, le lieutenant Ellen Ripley (incarnée par Sigourney Weaver) entend opposer une résistance au destin d’asservissement, de colonisation du corps réduit à la fonction de fertilité. Dans le film de James Cameron, elle se présente comme un cyborg, revêtue d’un exosquelette, afin d’intimider l’Alien. En vue de contrer sa sujétion-réduction à l’état de machine à engendrer, elle s’engage dans un devenir machinique, prothétique. Fécondée/violée durant son sommeil, plutôt que d’extirper l’embryon de reine d’Alien qui la squatte, Ripley tuera l’Alien et se donnera la mort en se jetant dans une fournaise avant d’être clonée dans Alien, la résurrection. Tertio, une référence à la figure de l’ordinateur-mère. L’ordinateur du vaisseau spatial Nostromo s’appelle Maman. Dans le film de Ridley Scott, c’est la voix de l’ordinateur qui extirpe les passagers de leur état biostatique et qui, autant que les ramener à la vie, leur donne naissance, rejouant leur sortie du ventre maternel. Régnant sur l’équipage qu’il contrôle, qu’il réveille quand une alerte se déclenche, il voit sa toute-puissance se payer d’un déficit de conscience : Maman (Mother, à savoir “mère” dans la version originale) ne se pense pas penser, sa non-conscience réflexive l’ordonne à sa représentation comme champ inconscient. Quarto, une référence métaphorique à la maternité au sens de cocon. Le Nostromo, le Sulaco, l’Auriga, le Prometheus et autres vaisseaux spatiaux forment chacun une matrice utérine où les membres de l’équipage vivent en biostase, plongés dans un état entre hybernation et régression fœtale le temps des voyages interstellaires. À ces trois archétypes féminins, plus exactement maternels, fait face l’aspect, la morphologie phallique des Aliens dessinés par HR Giger, inventeur de créatures biomécaniques hypersexuées, de type insectoïdes. Crâne allongé sans yeux, appendices dorsaux, queue longue et coupante, langue perforatrice munie d’une seconde bouche broyeuse : l’Alien que, dans le film de Ridley Scott, HR Giger tire de sa peinture Necronom IVcombine des attributs phalliques dans une anatomie revisitée autant que l’est sa chimio-biologie alors qu’il figure la Chose. Une Chose qui relève davantage d’un chaos primordial indifférencié que d’un espace maternel où fusionneraient mère archaïque et mère/femme phallique, fétiche.
Plutôt que s’aventurer dans des noces contre-nature, dans des appariements guêpe et orchidée, plutôt que de prendre le risque d’une construction/stylisation de soi, d’un façonnement d’une subjectivation, les humains tentent de maintenir la fiction d’une coupure étanche entre humanité et inhumanité, de strier l’espace en l’ordonnant à des séparations infrangibles avant d’intérioriser l’événement d’une plasticité mutante au principe de la vie, celle-là même qui loge le non-humain, le presque-humain au creux de l’humain, dans le brouillage des distinctions spéciques[7]. Dans cette subversion de la dialectique de la domination et de la servitude qu’acte la série, l’on dira, convoquant Judith Butler et Catherine Malabou : “bien qu’il n’y ait pas de corps qui soit mien sans le corps de l’autre, il n’y a pas de désappropriation définitive possible de mon corps, non plus que d’appropriation définitive possible du corps de l’autre”[8].
Si la série Aliensemble rendre toute catharsis impossible en ce qu’elle ne nous permet pas de bondir au-delà de l’affect de la terreur, de nous libérer de la crise d’épouvante, elle nous féconde paradoxalement d’une vérité qu’elle dépose comme un œuf. Une vérité qui révèle que le posthumain, le para-humain, le contre-humain est d’emblée, et non après coup, au cœur de l’humain.
[1]Alien, le huitième passager de Ridley Scott (1979), Aliens, le retour de James Cameron (1986), Alien 3 de David Fincher (1992), Alien, la résurrection de Jean-Pierre Jeunet (1997). Bien qu’indépendant de la série, Prometheus (2012) de Ridley Scott se présente comme une préquelle d’Alien, le huitième passager, et aura pour suite Paradise.
[2] Cf. Sur cet “œil des choses” qui laisse apparaître la différence ontologique, qui ouvre le plan de l’être pur, en deçà du rapport intentionnel noué sur le plan ontique, se reporter à la fine analyse que produit Jean-Clet Martin dans son texte L’Ontologie pure d’Alien.
[3]L’adversaire est refoulé dans une extériorité irrelevable des deux côtés de l’affrontement, tant du point de vue de l’humain que de celui de l’Alien.
[4]Dans Alien 3 de David Finchner, le parasitage d’un chien par un Alien donne naissance à un Alien quadrupède, fruit d’une recombinaison génétique de l’ADN du xénomorphe et de l’ADN de l’hôte. La modalité de reproduction par prédation implique chaque fois lors de l’accouplement une double modification du patrimoine génétique, tant du prédateur que de la victime.
[5]Cf. Tobie Nathan, Tous nos fantasmes sont dans la nature. Psychanalyse et copulation des insectes, Paris, Ed. Mille et une nuit, 2013.
[6]Barbara Creed, “Alien and the Monstrous-Feminine”, in Alien Zone, dir. A. Kuhn, London, Verso, 1990.
[7]Davantage que les humains de la saga qui font tout pour la repousser, ce sont les spectateurs qui intériorisent cette vérité.
[8]Judith Butler et Catherine Malabou, Sois mon corps. Une lecture contemporaine de la domination et de la servitude chez Hegel, Paris, Bayard, 2010, p.8.






.jpg)